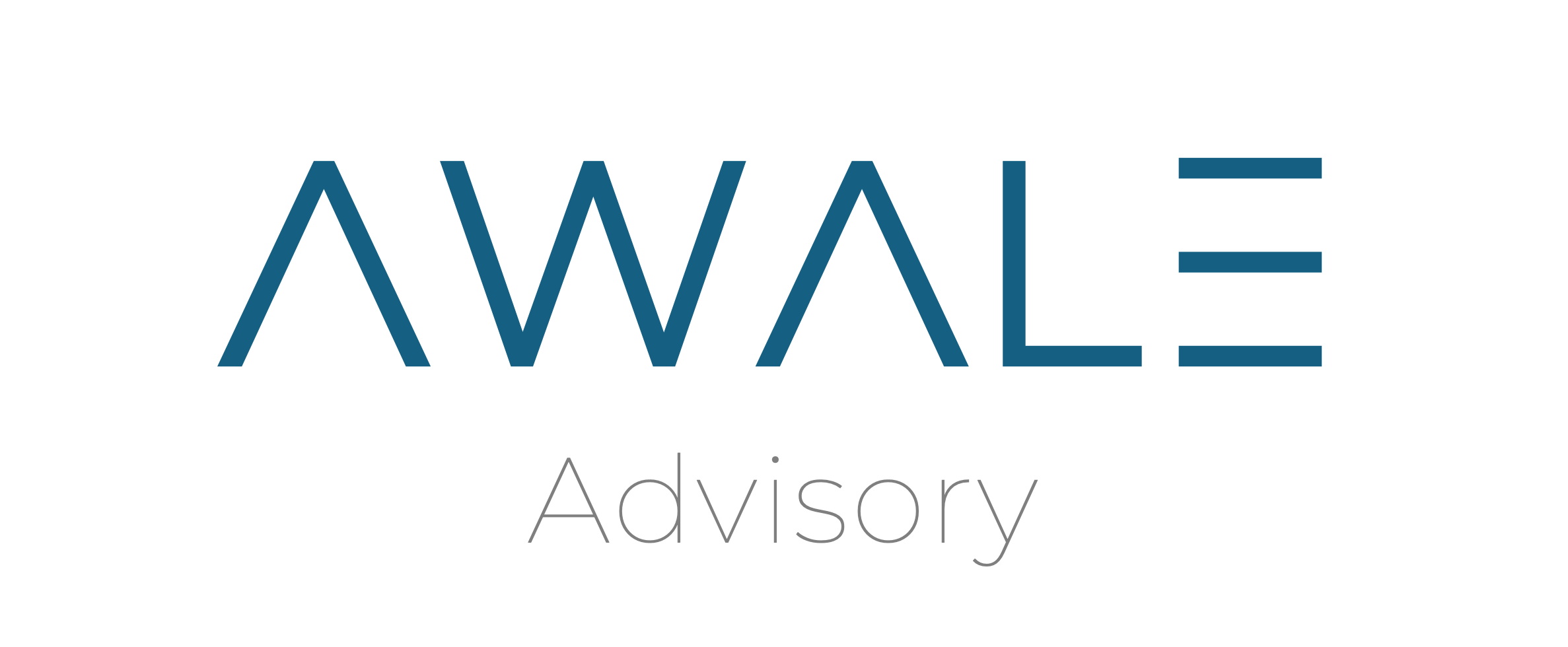Une approche trop prudente en matière de LBC/FT peut engendrer une exclusion financière comme effet pervers.
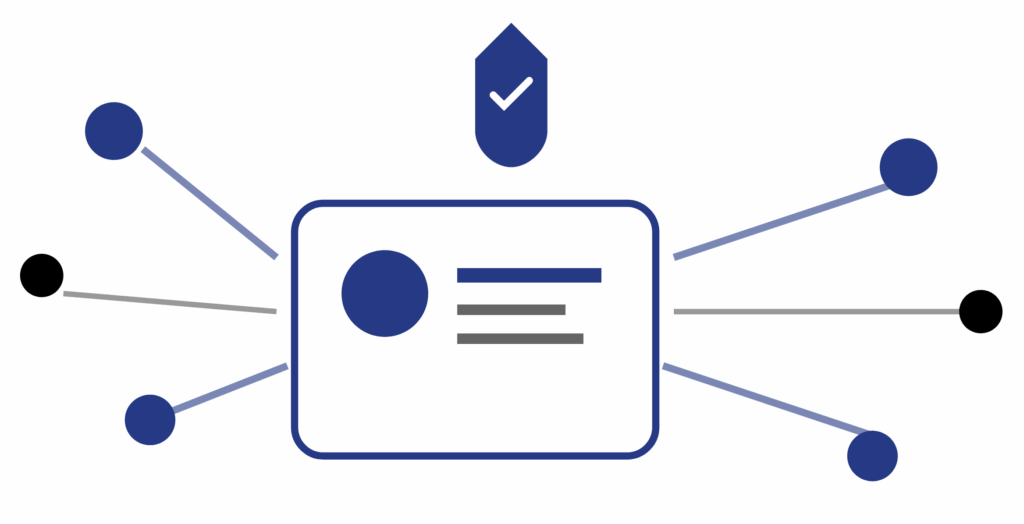
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié, en juin 2025, une mise à jour de ses recommandations (EN) pour mettre l’accent sur la complémentarité et le renforcement mutuel entre l’inclusion financière et l’intégrité financière, deux concepts qui ont souvent été perçues comme contradictoires en termes d’objectifs de politiques publiques.
En effet, dans ce qu’il appelle le paradoxe de l’excès de prudence, le GAFI note qu’une approche trop prudente en matière de LBC/FT peut engendrer une exclusion financière comme effet pervers. Cette exclusion se traduit principalement par un “de-risking” par les institutions financières, qui clôturent les comptes des personnes ou des entités considérées comme présentant un risque élevé en matière de LBC/FT, parfois pour éviter d’affronter les étapes de conformité réglementaire nécessaires. Des millions de personnes et d’entreprises sont ainsi poussées vers des circuits informels, moins transparents et plus vulnérables à la criminalité financière, augmentant de facto le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le GAFI reconnaît ainsi que l’exclusion financière elle-même sape l’efficacité des mesures LBC/FT et représente un risque réel pour la mise en œuvre de ses normes.
À l’inverse, permettre un accès élargi et approprié aux services financiers accroît la visibilité des flux, facilite la détection des transactions suspectes et protège les populations vulnérables contre l’exploitation criminelle. Pour ce faire, le GAFI recommande une approche plus flexible et basée sur les risques dans la mise en œuvre des mesures LBC/FT.
Cela revient principalement à :
- évaluer précisément les risques liés aux clients, produits, canaux et contextes locaux, sans appliquer des mesures standard face à tous les cas de figure ;
- alléger les exigences de connaissance du client pour les produits et clients présentant des risques faibles, via des mesures simplifiées ou progressives, tout en maintenant des contrôles renforcés là où les risques sont élevés ;
- éviter le « de-risking » de masse, car refuser ou fermer des comptes à des catégories entières de clients sans évaluation individualisée du risque est contraire aux recommandations du GAFI et accentue l’exclusion financière.
Permettre un accès élargi et approprié aux services financiers accroît la visibilité des flux, facilite la détection des transactions suspectes et protège les populations vulnérables contre l’exploitation criminelle.
Certes, les principaux freins à l’inclusion financière ne disparaissent pas immédiatement : le coût et la complexité des démarches d’ouverture de compte, l’absence de documents d’identité officiels dans beaucoup de régions du monde, le manque de confiance ou d’éducation financière, des réglementations trop strictes ou mal adaptées, etc. Toutefois, les différentes acteurs de la chaîne de l’inclusion financière peuvent agir.
Que faire ?
Pour les régulateurs et les décideurs en matière de politiques publiques :
- intégrer l’inclusion financière dans les stratégies nationales LBC/FT, et vice-versa ;
- permettre et encourager l’application de mesures simplifiées dans les scénarios à faible risque ;
- mettre en place ou faciliter un cadre réglementaire pour l’identification numérique et les comptes à paliers.
Pour les institutions financières :
- développer des produits adaptés aux besoins des populations non desservies ou mal desservies, avec des parcours clients simplifiés ;
- former le personnel à l’approche basée sur les risques et à la diversité des profils clients ;
- évaluer régulièrement l’efficacité des mesures et ajuster les contrôles en fonction de l’évolution des risques.
Pour les partenaires techniques et les bailleurs :
- soutenir l’innovation réglementaire (regulatory sandboxes, projets pilotes) ;
- encourager la digitalisation et l’interopérabilité des systèmes d’identification et de paiement ;
- financer des études d’impact et des campagnes d’éducation financière.